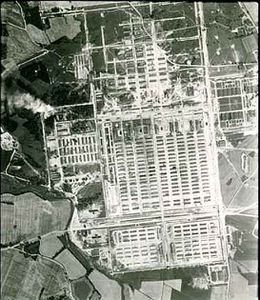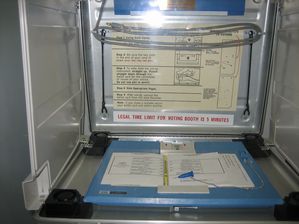Nous voilà une fois de plus confrontés au conflit larvé entre l’Islam et l’Occident, au « choc des civilisations » que d’aucuns veulent absolument provoquer au Moyen Orient par des guerres successives et en Europe, par populations immigrées d’origine musulmane interposées.
Le vivre ensemble est-il possible ? Doit-on répondre aux attaques et aux provocations d’un obscurantisme qui nous semble issu du fond du Moyen âge, mais aussi bien entretenu par de riches émirats pétroliers, par une hostilité constante, des interdits stupides ? Doit-on nous aussi attaquer par une répression aveugle, inefficace et ne générant que la haine ?
Ce serait non seulement odieux, contraire aux droits fondamentaux que nous ne cessons de proclamer, mais aussi stupide, car toute guerre ne génère que destructions et rancœurs.
On le sait. On le dit depuis longtemps partout, dans les médias, dans des colloques, par des publications de toutes sortes, via la toile. Tout cela est vain et ne sert qu’à entretenir notre bonne conscience.
Pour appréhender les choses, un récit est souvent plus évocateur que l’analyse la plus fine. Voici l’histoire de Rachid. Elle est authentique. Elle m’a été racontée par un proche parent de l’intéressé. Rachid est un pseudonyme et certains lieux ont été changés.
Espérons que ce récit permettra au lecteur de bien cerner cette problématique de vie commune qu’il est indispensable de résoudre pour assurer un avenir de paix, de sérénité et surtout d’ouverture d’esprit.
Pierre Verhas
Appelons-le Rachid. Le père de Rachid est originaire d’Algérie. Il naquit et il a grandi aux confins de la Kabylie et du Maroc. Maçon sans emploi, il émigra vers la Belgique où il travailla dur et parvint à fonder un foyer, élever ses enfants, les ouvrir à l’Instruction. Rachid, brillant élément, put effectuer des études universitaires et décrocha avec mentions un diplôme d’historien, de politologue et d’économiste.
Rachid qui, dès son adolescence, milita à gauche, à l’école, puis à l’Université, fut engagé, eu terme de ses études universitaires, au bureau d’étude de la FGTB (Fédération Générale du Travail de Belgique, syndicat d’obédience socialiste). Il se sentait bien dans ce premier emploi, mais Rachid avait une vocation : l’enseignement.
Il savait que l’apprentissage de la vie, ne pouvait se faire sans la transmission de la connaissance et surtout, sans le développement de l’esprit critique. Il en avait vécu la nécessité, ayant vu son père et sa mère au labeur pour lui permettre, ainsi qu’à ses frères, d’avoir une place dans la société belge. Rachid, homme de gauche, était libre penseur, mais ses lointaines racines kabyles vivaient en lui et il respectait la religion de ses parents, même si, comme bien d’autres à cette époque, il ne pratiquait qu’aux grandes occasions.
Doté de son brillant bagage intellectuel, Rachid n’eut aucune peine à décrocher un emploi de professeur d’histoire dans un prestigieux établissement d’enseignement de la Ville de Bruxelles. Sa première leçon fut pour lui un profond moment de bonheur, il eut le sentiment d’être enfin utile, et il avait l’impression d’avoir enfin été admis à part entière dans cette société belge si fermée aux étrangers. Il décida d’organiser son cours dans le strict respect du programme, avec en outre une ouverture sur le monde et en développant l’esprit d’analyse de ses élèves : il fit en sorte qu’ils soient plus que de simples auditeurs en participant, par de nombreux exercices, à un examen critique de l’histoire. Mal lui en prit !
Au terme du premier trimestre de l’année scolaire, Rachid participa à sa première réunion de parents – professeurs. D’emblée, il sentit pointer vers lui ces regards qu’il connaissait bien, à la fois curieux et réprobateur. Il avait trop vécu cela au quotidien dans la rue, dans le bus, à l’école et même à l’Université. Rachid n’est pas d’ici et ils en ont peur. Ces regards l’insultaient bien plus que les injures lancées par quelques racistes éméchés.
Ces gens, les parents de ses élèves, de « ses gamins » comme il les appelait avec affection, ne l’aimaient pas. Ces parents faisaient pour la plupart partie de la moyenne bourgeoisie. Ils habitaient les « beaux » quartiers, à ne pas confondre avec « les quartiers », où vivaient les « étrangers ». Par ces regards déplaisants et dans ce silence pesant, c’était l’affrontement de deux ghettos hostiles. Rachid attendit le premier assaut. Un père revêtu d’un costume bien taillé, aux cheveux grisonnants lui reprocha l’excès de travaux pour un cours secondaire. Rachid rétorqua que ces exercices servaient à développer l’esprit critique de ses élèves et que cela leur servirait dans d’autres domaines. Un autre père, un roquet nerveux à barbichette, attaqua de sa voix de crécelle :
- Contentez-vous d’enseigner l’histoire ! Le reste n’est pas votre affaire.
Mais l’estocade vint d’une mère, une dame distinguée, revêtue d’un tailleur bleu, portant une broche dorée. Rachid connaissait cette dame. Il la voyait souvent bavarder avec quelques-unes de ses collègues à la sortie des cours. Comme elle avait le verbe haut, il l’entendait de temps à autre prononcer des discours sur la laïcité, la libre pensée et les menaces pesant sur l’école officielle. Elle devait certainement être une militante active dans les ligues laïques.
- Croyez-vous être à votre place, ici, jeune homme ? Vous devriez y réfléchir !
Rachid ne répondit rien. Il n’y avait rien à dire. La libre pensée ? Non, elle n’est pas universelle. Ces gens qui ont l’illusion d’encore dominer le monde, l’ont accaparée. En effet, Rachid n’était pas à sa place ici. Il était toléré, parce qu’il le fallait bien, mais il ne sera jamais admis. Rachid espaça ses exercices, poursuivit son cours en se conformant strictement au programme. Il n’avait plus le feu sacré. Il décida de changer d’école, d’aller dans un établissement en milieu populaire. Sans doute y serait-il mieux, sans doute y serait-il à sa place.
À la rentrée suivante, il fut affecté comme professeur d’économie dans une école secondaire professionnelle sise dans un quartier à forte densité de « population allochtone », comme on disait. Lorsque Rachid entra pour la première fois dans sa classe, il y avait une trentaine d’élèves âgés de quatorze à seize ans, tous des garçons, la plupart issus comme lui « de l’immigration ». Nul ne se leva. L’attitude des élèves était hostile, mais il ne s’agissait plus des regards condescendants qu’il connaissait trop bien ; ici il ressentit plus de haine que de mépris. Rachid s’assit à son petit bureau sur l’estrade. Il sortit de sa serviette la liste des élèves et commença l’appel. Au premier nom, il reçut comme réponse un grognement. Il obligea l’élève à se lever. Ce qu’il fit en bougonnant. Rachid lui infligea une retenue en punition. Un murmure réprobateur traversa la classe. Un élève au fond, un Maghrébin assez grand, rouleur de mécaniques, sans doute le petit caïd de la classe, se leva et hurla :
- Tu n’as pas le droit de le punir ! La loi, c’est nous, M’sieur !
Rachid se leva et s’approcha du trublion.
- Un prof, on l’appelle par « vous », quel est ton nom ?
Le gamin le toisa avec un sourire méchant.
- Ahmed ! Et tu ne vas pas rester longtemps ici, M’sieur !
Un autre élève se leva. Il hurla :
- Ici, on n’aime pas les traîtres ! T’as qu’à te casser !
Rachid fit un terrible effort pour garder son sang froid. Il s’approcha lentement de ce provocateur qui fit un léger mouvement de recul
- Traître, tu as dit ? Sais-tu au moins ce que ce mot signifie ?
C’est un autre élève qui répondit :
- Tu es un frère et tu bosses pour eux !
Voilà le problème ! Il était Maghrébin et ces jeunes paumés de la fameuse « troisième génération » ne pouvaient supporter qu’un des « leurs » puisse exercer la moindre parcelle d’autorité avec « eux ». L’école, les profs, la police, c’étaient « eux ». « Eux » c’étaient leurs ennemis.
Rachid en resta là. Il ne servait à rien de punir. D’un autre côté, il devait exercer son autorité et c’était mission impossible. Il fit appeler le directeur qui décréta une retenue générale, mais qui le réprimanda pour son manque de fermeté. Les semaines suivantes, son cours se passa dans un calme relatif, mais il ne parvint jamais à capter l’intérêt de ses élèves qui le rejetaient. Il était et il se sentait désormais inutile.
Il rencontra par hasard le directeur du bureau d’études de la FGTB. Rachid lui raconta son histoire. Le directeur lui proposa de reprendre du service, car il avait toujours besoin de ses compétences. Et puis, il verrait bien, après. Rachid accepta et démissionna de l’enseignement.
Rachid était blessé, sans doute à jamais. Ses illusions s’étaient définitivement envolées, mais surtout, il garda le sentiment d’une haine larvée de part et d’autre. De part et d’autre ! Il y avait donc deux parties qui ne se rencontraient jamais qui décrétaient leur hostilité réciproque et qui, pourtant, devaient vivre côte à côte, sinon ensembles. Le rêve d’une société de rencontre se transformait en un cauchemar d’une guerre entre des groupes qui, s’ils ne s’affrontaient, s’ignoraient.
PV