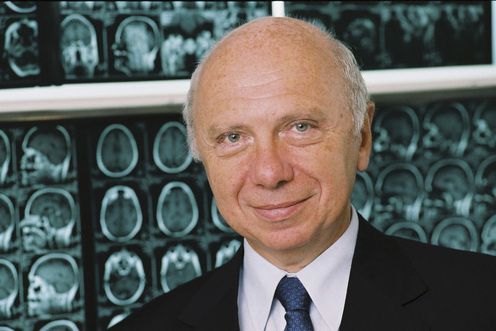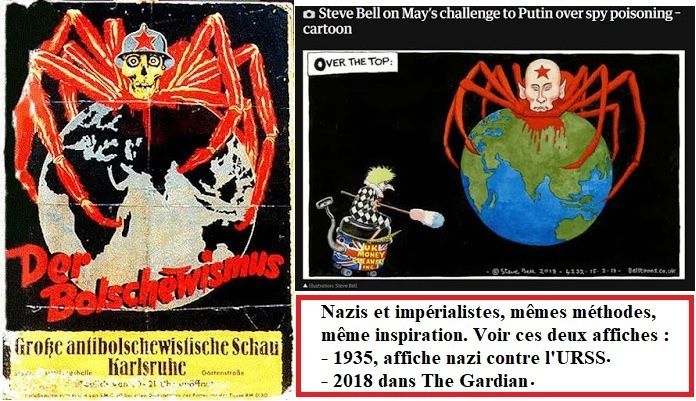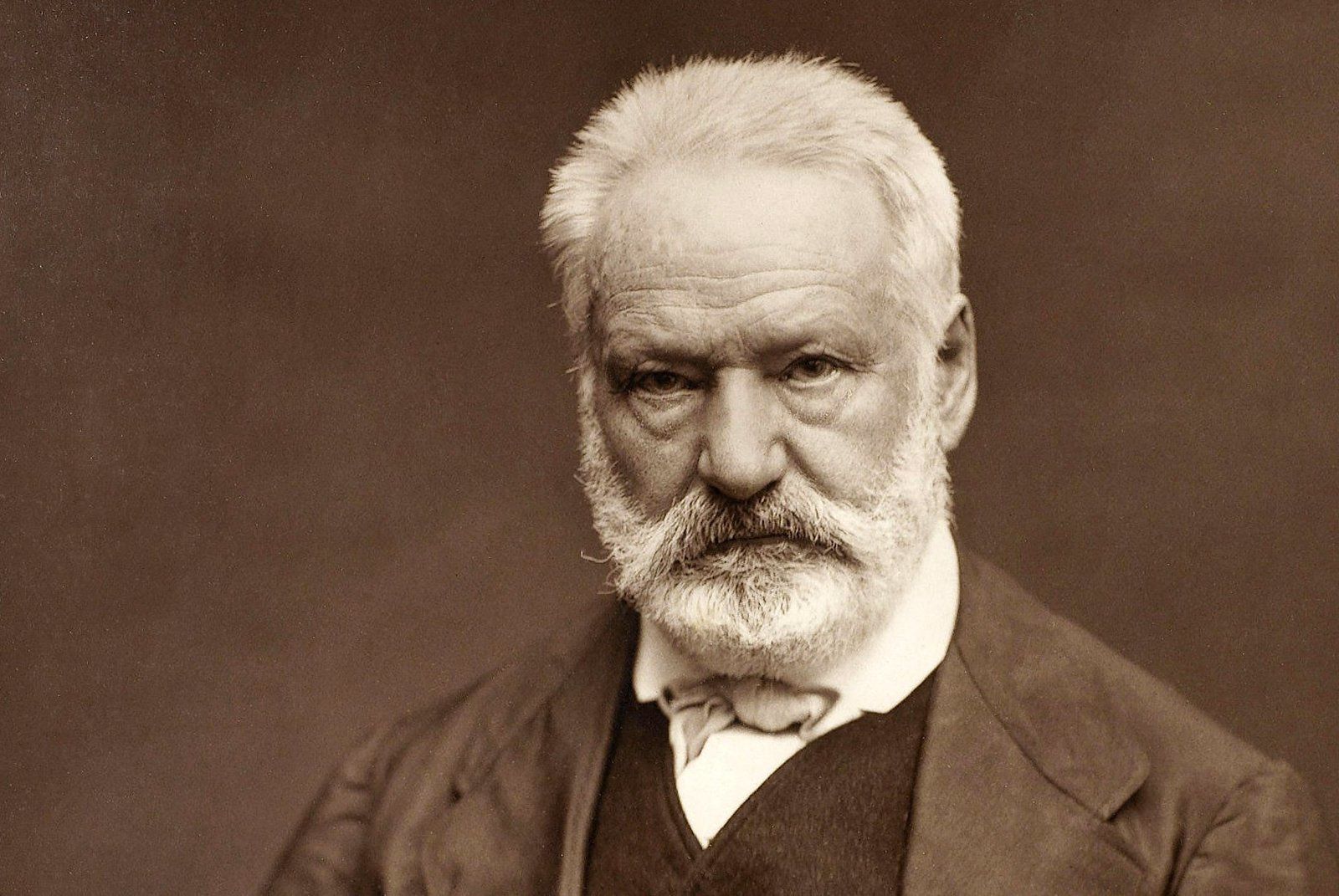« Nous sommes l’un des rares pays [Etats-Unis], certainement l’une des rares sociétés développées, à ne pas avoir de transports à grande vitesse. On peut prendre un TGV de Pékin au Kazakhstan, mais pas de New York à Boston. À Boston où j’habite, beaucoup de gens passent trois à quatre heures par jour simplement dans les transports. C’est une perte de temps colossale. Tout cela pourrait être évité grâce à un système rationnel de transports en commun qui contribuerait de manière significative à régler le problème majeur auquel nous sommes confrontés – à savoir la destruction de l’environnement. »
Voilà ce qu’écrit Noam Chomsky, le célèbre linguiste et militant progressiste américain dans un de ses derniers ouvrages Requiem pour le rêve américain, Flammarion, climats, 2017. En effet, il est impossible de construire une ligne de TGV aux Etats-Unis, car aucune entreprise privée n’a la possibilité d’un tel investissement dont la rentabilité est à long terme.
Privatiser les bénéfices, socialiser les pertes
Voilà la preuve, s’il en fallait, que le service public est indispensable pour disposer d’infrastructures modernes, efficaces et rentables. Mais non. Avec les chemins de fer qui nécessitent de grosses infrastructures assez coûteuses, les néolibéraux ont appliqué le principe bien connu : privatiser les bénéfices, socialiser les pertes.
Mais, cela est profondément inepte : on fait payer les investissements par le contribuable et l’usager et le privé empoche les profits.
Ainsi, en Grande Bretagne, l’exploitation des chemins de fer a été « ouverte à la concurrence » pour reprendre le jargon néolibéral. Ainsi, plusieurs compagnies privées exploitent le réseau ferroviaire. Résultats : les prix ont considérablement augmenté, ils varient au cours d’une même journée, les fréquences ont été réduites et les horaires ne sont pas respectés. C’est à tel point que 60 % des usagers britanniques demandent la renationalisation des chemins de fer.
Quant à l’infrastructure, elle reste entre les mains du secteur public. Résultats : les déficits augmentent et alimentent la dette publique au plus grand profit des banques.
On pourra rétorquer que là où les sociétés de chemins de fer sont encore publiques, les inconvénients sont équivalents. C’est exact. Cependant, les causes ne sont-elles pas les mêmes ? La diminution des dotations de l’Etat, la perte de recettes par la privatisation des transports de frets qui sont confiés à la route, la scission des sociétés publiques en deux filiales : l’exploitation du transport des personnes et la gestion de l’infrastructure. Et cette scission a été faite pour préparer « l’ouverture à la concurrence ». Autrement dit, ce qu’on pourrait appeler la « pré » privatisation est la cause des déboires. Et ce n’est sans doute pas un hasard !
En sabotant le service public, on fait accepter le principe de la privatisation par l’opinion. Et on impose la « seule politique possible » - le fameux TINA thatchérien – le modèle néolibéral.
Le dogme à la mode porté haut et fort par l’Union européenne est : la concurrence et le marché sont « la » solution, comme l’écrit Jean-Michel Naulot, ancien régulateur financier et membre du Collège de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). C’est dire qu’il s’ait de quoi il parle.
Qu’il s’agisse de la SNCF en France, de la SNCB ou des pensions en Belgique, on commence par dénoncer les « privilégiés » qui coûtent cher à la société. Les « privilégiés » en l’occurrence, ce sont les cheminots qui bénéficient d’un régime spécial et les fonctionnaires pensionnés. « Les fonctionnaires, voilà l’ennemi » titre un article signé Anicet Le Pors, ancien ministre communiste de la Fonction publique française, dans le « Monde diplomatique » du mois d’avril 2018.
Le piège
L’objectif au nom de théories économiques fumeuses que l’on impose dans les médias et dans les universités, est avant tout politique : les intérêts privés prennent en main tous les services d’intérêt général, c’est-à-dire les services publics : cela va des sociétés de transports publics aux prisons en passant par les écoles, les services sociaux et surtout la sécurité sociale. Et c’est un piège !
Cette dogmatique est extrêmement dangereuse et vise à éliminer la puissance publique. Jean-Michel Naulot l’a rappelé au sujet de la crise financière de 2007-2008 :
« Au moment où s’engage une « transformation » de la SNCF, selon le mot utilisé autrefois par Jean-Jacques Servan Schreiber qui pensait lui aussi que l’on pouvait changer la société française d’un coup de baguette magique afin de rattraper notre « retard » sur le modèle américain, il est normal que l’inquiétude s’exprime.
La réforme en cours n’est pas sans rappeler quelques souvenirs à l’ancien régulateur que je suis. En novembre 2007, alors que nous étions entrés dans une crise financière très grave depuis l’été, nous étions nombreux à nous interroger, régulateurs et acteurs financiers, sur la pertinence d’une directive européenne qui mettait fin au monopole de la société Euronext pour traiter les transactions boursières à Paris. Nous savions que nous entrions dans une crise provoquée par une insuffisance de la régulation et l’on nous demandait de donner un coup d’accélérateur dans la voie de la dérégulation ! L’introduction de la concurrence, nous disait-on, réduira les coûts pour les clients.
Très vite, cette directive a effectivement produit ses effets… ! De nombreuses plateformes de transactions ont été créées et elles se sont spécialisées sur les courants d’affaires les plus rentables (le traitement des grandes valeurs). Le volume de transactions réalisé par Euronext étant désormais réparti en de multiples plateformes, une liquidité du marché plus faible a été constatée. Il en est résulté un coût plus élevé pour les clients. Par ailleurs, la concurrence tirant les pratiques vers le bas, la transparence a été réduite. Quant aux opérateurs du trading à haute fréquence, jusque-là marginaux sur le marché, ils ont été comblés. En un rien de temps, ils ont pris 50% du marché des actions. La recherche du meilleur prix parmi les multiples plateformes devenait en effet un exercice complexe qui exigeait le recours à des ordinateurs très puissants. Depuis, les régulateurs ne savent comment réduire leur emprise… En quelques mois, les clients qui étaient censés profiter de la réforme ont ainsi constaté que l’évolution du marché des actions n’était pas du tout conforme à ce qui avait été annoncé. »
Et en dehors de cet aspect économique et financier, il y a une conception fondamentale de la société à défendre et à illustrer. Mais elle se heurte à la sacro-sainte rentabilité. Pour les néolibéraux, sans être rentables, les services publics sont intenables. Le professeur honoraire d’économie Jean Gadrey de l’Université de Lille I rappelle :
« Il faut, avant tout autre argument, défendre les missions d’intérêt général des services publics (dont les services publics dits de réseau comme la SNCF) au nom d’une vision solidaire de la citoyenneté moderne. Ne pas recevoir le courrier ou ne pas pouvoir en envoyer dans des conditions acceptables, ne pas recevoir l’eau potable, ne pas pouvoir se raccorder à un réseau téléphonique, ne pas recevoir l’électricité, ne pas pouvoir se chauffer, ne pas avoir de « transports en commun » locaux ou nationaux accessibles à un prix abordable, sont des indices d’une citoyenneté de seconde zone, dans une société divisée entre ceux qui sont connectés aux réseaux de la vie quotidienne et ceux qui ne le sont pas. Tel est l’argument principal des défenseurs des missions de service public, lesquelles ne peuvent pas être « rentables » au sens financier, même lorsque leur utilité écologique et sociale est considérable. »
Des trains de camions
Bernard Thibault, l’ancien secrétaire général de la CGT aujourd’hui administrateur au Bureau International du Travail explique dans une interview à l’hebdomadaire « Marianne » du 8 avril 2018 les dangers du démantèlement et de la privatisation de la SNCF. En plus de donner tout le pouvoir au secteur privé, il menace la transition écologique.
Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT, plaide pour une coopération entre les services publics en Europe.
« Le changement climatique impose qu’on s’interroge partout sur les finalités de son travail pour produire et transporter autrement. (…) Actuellement, les neuf dixièmes du transport de marchandises se font par camions. Les populations riveraines des axes les plus fréquentés subissent la pollution, la détérioration des chaussées, rénovées par leurs impôts. À l’horizon 2030-2050, les perspectives sont alarmantes : si rien ne change, si l’Europe se contente de mettre en concurrence ses opérateurs de chemin de fer, plutôt que d’organiser leur coopération et de booster leurs investissements, le nombre de poids lourds en circulation va être multiplié par deux ! Nous n’aurons plus des trains, mais des trains de camions. »
La coopération au lieu de la concurrence
Voilà donc la démonstration que le service public peut être un facteur innovant majeur pour l’économie de demain. La coopération entre les sociétés publiques de chemin de fer au niveau européen, au lieu de la concurrence permettrait d’immenses progrès au niveau du transport aussi bien de personnes que de marchandises.
Non seulement, il y aurait une capacité d’investissement inégalée qui permettrait de moderniser tous les réseaux aussi bien de grandes lignes que régionaux.
En rétablissant le transport de fret par chemin de fer, on mettrait un frein à la pollution, le coût des infrastructures routières serait substantiellement réduit et on pourrait aussi diminuer le coût même du transport.
Il y a quelques années, on avait effectué plusieurs expériences dites de ferroutages qui consistent à mettre des camions sur des wagons de chemin de fer. On a abandonné cette idée. C’est une erreur. On pourrait très bien envisager le ferroutage généralisé aux réseaux de chemin de fer européens en modifiant certaines infrastructures permettant une coordination entre la route et le chemin de fer.
Mais cela nécessite une force politique à même de renverser la métamorphose entamée depuis deux décennies par les néolibéraux. Cette force ne peut qu’être supranationale et elle est indispensable pour donner à l’Union européenne un autre visage que celui de flic de l’économie politique néolibérale.
Pour le service public européen
Aussi, non seulement pour les chemins de fer, mais aussi dans pratiquement tous les domaines de l’activité humaine, de l’éducation à la santé publique, des chemins de fer à la Poste et aux télécommunications, de la culture à la recherche scientifique, de la distribution d’eau à la politique énergétique, de la politique du logement à la gestion du réseau routier, il convient non pas de mettre en concurrence, mais d’instaurer la coopération.
Et pour cela, il convient d’étudier une nouvelle notion à mettre en œuvre : le service public européen.
Cette idée sera évoquée dans de prochains articles. Et laissons la conclusion à Anicet Le Pors :
Anicet Le Pors, ancien ministre communiste du premier gouvernement Mauroy estime que le XXIe siècle sera celui des services publics.
« Dans une crise qu’Edgar Morin analyse comme une « métamorphose », des valeurs universelles émergent et s’affirment : les droits humains, la protection de l’écosystème mondial, l’accès aux ressources naturelles indispensables, le droit au développement, la mobilité des personnes, l’égalité entre les hommes et les femmes, le devoir d’hospitalité, la sécurité. D’autres sont en gestation, qui exacerbent les contradictions. La mondialisation n’est pas seulement celle du capital ; elle touche toutes les formes d’échange et de formation de la citoyenneté : révolution informationnelle, coopérations administratives et scientifiques, conventions internationales, floraison de créations culturelles. Bref, ce siècle sera peut-être celui des interdépendances, des interconnexions, des coopérations, des solidarités, toutes formules qui se condensent en France dans le concept de service public. On ne s’en rend peut-être pas compte tous les jours en écoutant M. Macron, mais, contrairement aux espoirs et aux proclamations des thuriféraires du libéralisme, le XXIe siècle pourrait annoncer l’âge d’or du service public. »
Pierre Verhas